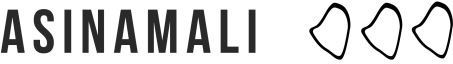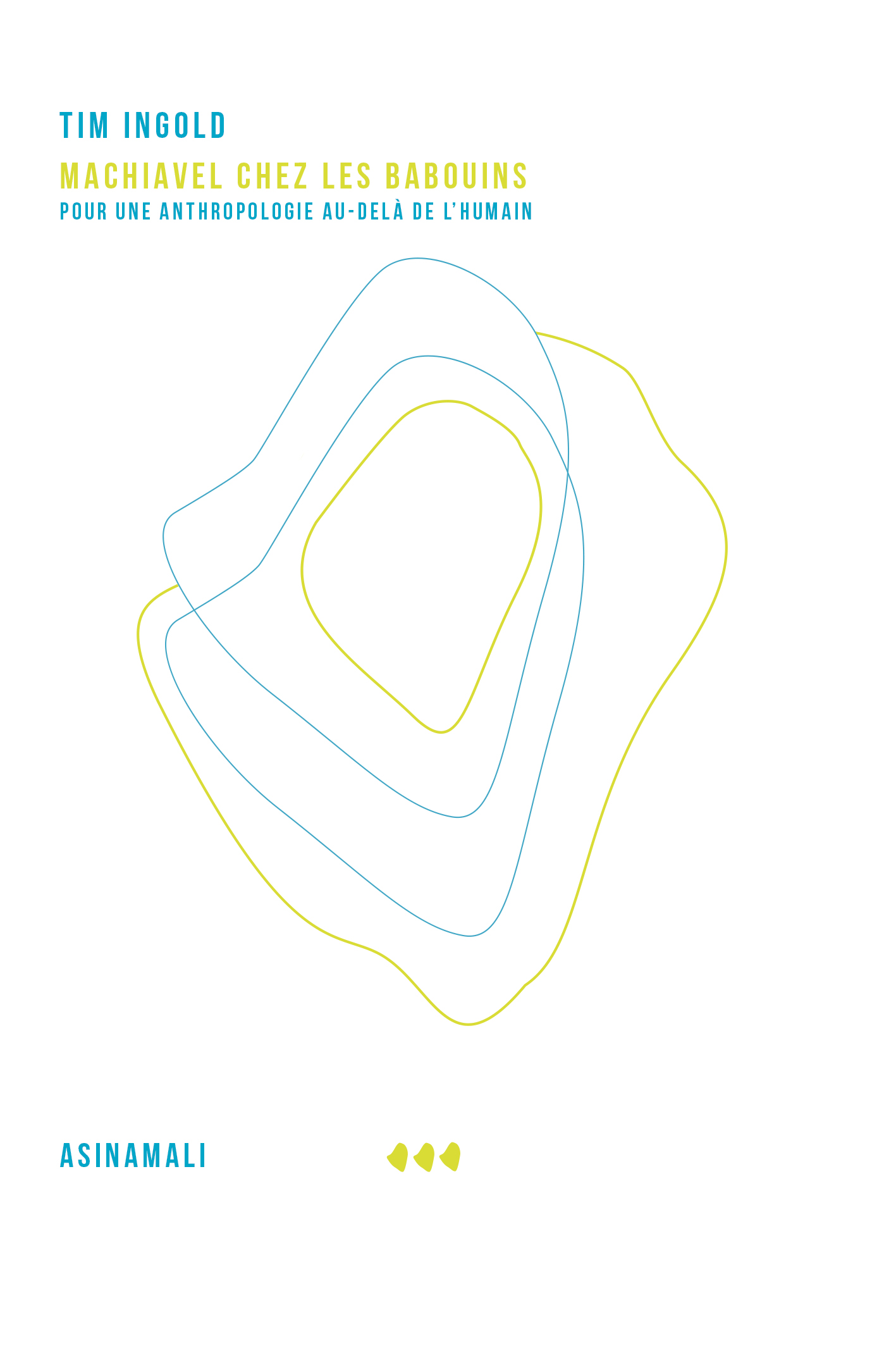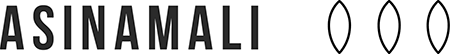« Pourquoi les anthropologues, plus que toute autre catégorie d’êtres humains, finissent-ils toujours par s’intéresser davantage aux animaux qu’à leurs congénères ? » La question aurait eu de quoi surprendre voici vingt ans, tant on s’était échiné jusqu’alors à définir le social comme l’apanage de l’espèce humaine et son étude le pré carré de l’anthropologie. Aujourd’hui, alors que les animaux sont entrés de plain-pied dans les sciences sociales, la question n’étonne plus guère. Mais est-elle seulement bien formulée ? Depuis ses premiers terrains auprès d’éleveurs de rennes en Finlande jusqu’aux synthèses qu’appellent les fins de carrière universitaire, Tim Ingold n’a cessé de faire varier les termes pour rejouer la question. Par exemple : « Pourquoi penser que les relations sociales sont limitées à des individus de la même espèce ? » À la jonction de la biologie, de l’écologie et des sciences sociales, l’anthropologue tente d’élaborer une méthode commune qui ne résumerait pas humains et non-humains à des êtres mus par leurs intérêts, en quête des stratégies les plus efficaces pour survivre, ni n’en ferait des agents sociaux identiques, capables seulement de nouer des liens entre semblables. Si l’on reconnaît que la vie est un tissu toujours remis sur le métier, où s’entremêlent des individus et des collectifs, quelle que soit leur espèce, la notion même d’espèce pourrait bien se révéler caduque. C’est, du moins, ce qu’envisage Ingold dans le dernier texte de ce recueil rassemblant des contributions sur près de trente années. S’il conclut en définissant ce que serait une « anthropologie au-delà de l’humain », c’est toute l’anthropologie qu’il embarque concomitamment, en tant qu’elle « ne se définit pas par son objet, comme si l’on mettait en lumière les humains en laissant tout le reste dans l’ombre, mais par sa méthode de travail qui consiste à apprendre des choses en participant à la vie d’autres personnes ».