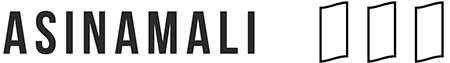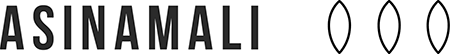Grâce à la traduction inédite de deux de ses essais, la pensée de la philosophe italienne Eleonora de Conciliis est désormais accessible en français. Après avoir exploré les liens entre anthropologie et anarchisme, réactualisé la conscience de classe prolétarienne et donné dans l’érotisme insurrectionnel, les éditions Asinamali poursuivent leur travail sur la pensée contemporaine italienne en mobilisant des thématiques qui leur sont chères : le matérialisme, les corps, la subversion politique. C’est cette fois par le biais de la violence et de l’écriture que ces différents points sont abordés.
Les éditeurs ont choisi de juxtaposer deux essais écrits à plusieurs années d’intervalle, mais dont l’attention aux corps et à la subjectivité assure la continuité. Le premier analyse la violence comme un fondement des relations qu’entretient toute personne avec le monde dans lequel elle évolue. L’autrice, déplorant le peu d’attention de la philosophie moderne pour ces questions, suit un raisonnement en trois temps, depuis l’anthropologie historique de René Girard jusqu’à une nouvelle de Kafka, en passant par la morale existentialiste de Sartre. Le second essai s’applique quant à lui à remobiliser le concept psychanalytique de sublimation, à travers la pratique de l’écriture littéraire et philosophique. Si les deux textes sont indépendants dans leur développement respectif, une thèse les relie néanmoins : la violence est une épreuve nécessaire à la définition de soi.
Pour saisir le sens de la violence, l’autrice rappelle au début du premier essai qu’« il faut […] éviter la purification et se plonger dans la souillure, c’est-à-dire dans la corporéité des actes violents » (p. 24). L’approche philosophique moderne – dont elle donne malheureusement peu de références – a selon elle perdu en clarté à mesure qu’elle gagnait en abstraction : réfléchir à la violence implique pourtant de concrètement s’y confronter. La distinction usuelle entre une violence brute et une autre, réfléchie, fruit de cette épuration conceptuelle, n’aurait alors pas grand sens : « violence et raison tendent à se recouper plutôt qu’à se distinguer » (p. 25). À rebours de René Girard selon qui la religion permettrait, par sacrifice ou expiation, de maintenir la violence hors de la cité, l’autrice soutient que ce serait là l’une des façons de l’engendrer « à l’intérieur de la communauté » (p. 30). On pourrait lui rétorquer néanmoins qu’une mobilisation de théories fondées hors du cadre occidental aurait permis d’étayer la réflexion1. Elle évacue ainsi rapidement la violence collective et politique, qu’elle soit révolutionnaire, réactionnaire ou institutionnelle.
C’est dans le sillage de Sartre et à propos du sujet que se place plutôt l’autrice. Selon le philosophe existentialiste, la violence serait constitutive des rapports sociaux et précéderait subjectivité et liberté. Relationnelle autant que rationnelle, la violence ne serait pas un acte social et collectif, mais avant tout relative à soi, ou aux autres dans une pratique esthétisante. Pour l’autrice, le raffinement présent dans la violence met en jeu un « style », qu’on pourrait définir selon deux formes : l’exhibition, lorsque l’acte est destiné à autrui, et l’exercice, comme Foucault a pu le mettre en lumière dans la sexualité antique2, lorsque l’acte se destine à l’acteur lui-même, dans l’ascèse ou la flagellation.
Ces deux sens, exhibition et exercice, se télescopent dans une nouvelle de Kafka écrite en 1914 : La Colonie pénitentiaire. Son étude constitue le dernier temps de ce premier essai. À partir de celle-ci, l’autrice développe ce qui selon elle constitue la ligne de crête de la violence, entre gestion productive d’une part et renversement stupide dans ses limbes de l’autre. Le titre de l’ouvrage, Violence et métamorphoses, prend ici tout son sens. Pour l’autrice en effet, « la seule antidote contre la violence est […] sa métamorphose ou son élaboration linguistique » (p. 28). Inséparable de la constitution de soi, la violence doit toutefois être surmontée avant qu’elle ne perde le sujet dans ce que la philosophe nomme indistinctement « bêtise » ou « stupidité ». Elle illustre cette thèse en reprenant les figures de l’officier et de l’étranger dans la nouvelle de Kafka. L’un et l’autre, plutôt que de dépasser la violence qui les anime et qu’ils craignent, s’engouffrent dans sa mécanique.